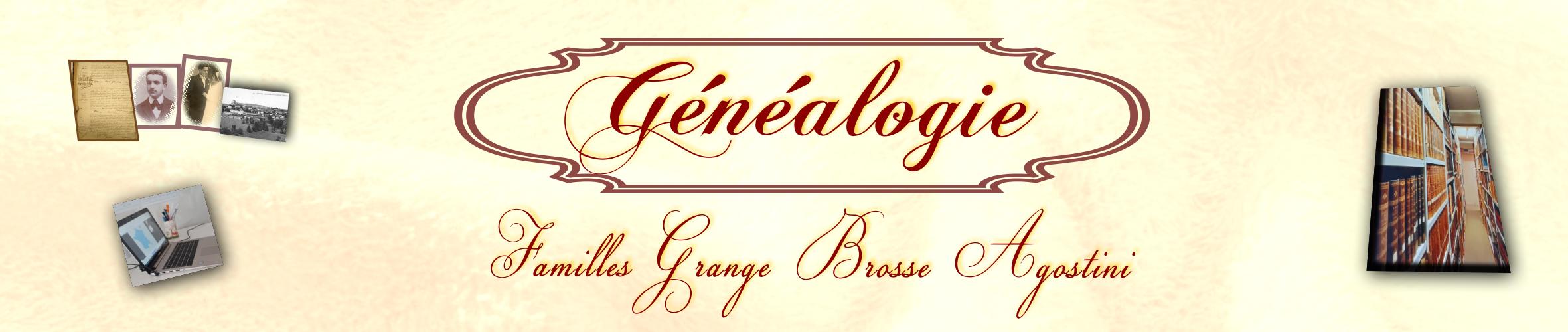Quelle est l’origine des noms de famille ?
Gaule, empire Romain et invasions barbares : des usages différents du nom de famille
En Gaule d’abord, seul un nom unique était donné aux individus. Ce nom était souvent lié à une qualité, un métier ou à un exploit. Il ne se transmettait pas.
Mais l’expansion de l’empire Romain diffuse largement l’emploi du nom romain, composé d’un prénom, d’un nom et d’un surnom, jusqu’au IIIe siècle.
L’arrivée des invasions barbares remplace l’usage du nom romain par des noms d’origine germanique, souvent composés de deux syllabes. Le nom ne se transmet toujours pas.
Puis, l’expansion du christianisme a imposé que les baptisés choisissent un nouveau nom d’usage pour marquer leur nouvelle croyance.
Au Moyen-Âge, le nom de famille se démocratise
Les noms de famille à l’époque médiévale sont surtout d’origine germanique. Alors que les populations ne cessent de croitre, l’usage du prénom est nécessaire dès le Xe siècle pour distinguer les individus.
Beaucoup de noms de saints seront donnés, ainsi que des surnoms individuels. Ceux-ci deviendront, ensuite, des noms de famille. A partir du XIIe siècle, la transmission du nom dans la famille se fait naturellement.
Il est considéré aujourd’hui qu’un nom de famille peut provenir de ces quatre origines :
- Il peut être issu du nom de baptême, d’un surnom, d’un nom d’usage ou du diminutif du prénom du père (ex : Martin, Jean, Bernard, Thomas, Jeannot, Hanin…)
- Il peut être lié à une localisation (ex : Dupont, Dubois, Dulac, Duchêne…)
- Il peut correspondre à nom de métier (ex : Boucher, Masson, Lemaire, Clerc, Marechal…)
- Il peut désigner un trait de caractère, du physique ou un exploit (ex : Roux, Leblanc, Lamy, Legrand, Champion…)
L’Epoque moderne ou la régulation de l’usage des noms de famille
Si depuis le XIIe siècle le nom se transmet de génération en génération, notez qu’au XVe siècle, seul le roi pouvait autoriser un changement de nom. S’en suit en 1539 l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier pour obliger la tenue de registres de baptêmes et sépultures et formalisant l’enregistrement par écrit des noms de famille. C’est à cette période que l’orthographe du nom est formalisée. Notez que pour faire votre généalogie, vous ne devez pas vous attarder sur une seule et unique orthographe de votre nom de famille, celui-ci a pu évoluer tant phonétiquement qu’orthographiquement au fur et à mesure du temps.
26 mars 1555, l’Edit d’Henri II confirme l’interdiction de changer de nom sous peine d’une amende et d’être privé des privilèges de noblesse. Mais celui-ci sera révoqué le 17 août 1556 à la demande du Parlement de Normandie.
Il faudra attendre plusieurs années avant qu’en 1579, la Grande ordonnance de Blois d’Henri III, n’ordonne la tenue de registres des actes de mariage et l’interdiction, de nouveau, de changer de nom sans autorisation préalable du roi.
Des siècles plus tard, en pleine Révolution française, la Convention montagnarde du 14 novembre 1793 autorise une grande liberté dans les changements de prénoms et de noms, possibles sur simple déclaration à la municipalité. Mais la Convention thermidorienne du 3 août 1794 met fin à cette liberté et instaure que chaque citoyen ne pourra porter que les prénoms et nom figurant sur son acte de naissance.
A quelques jurisprudences près, cette convention est toujours d’actualité dans le système français.