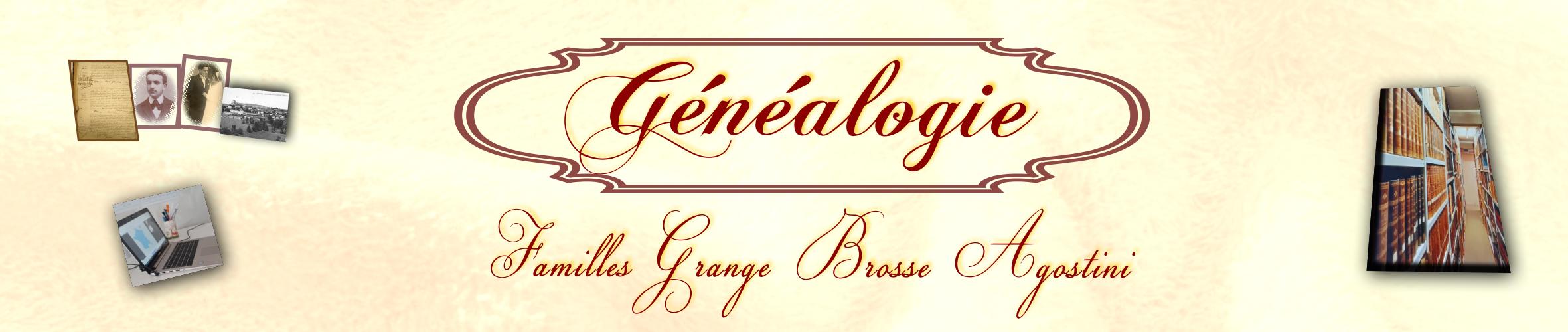NOYON
(Source Wikipédia)
ORIGINE ET GRANDS FAITS HISTORIQUES
La ville a été fondée à l'époque gallo-romaine. Elle faisait partie de la cité des Viromanduens. C'était une petite ville qui bénéficiait de sa position à proximité de la vallée de l'Oise. L'Itinéraire d'Antonin indique le nom de Noviomagus à son possible emplacement. L'agglomération gallo-romaine était située sur la via Agrippa de l'Océan sur le tronçon Augusta Suessionum (Soissons) - Samarobriva (Amiens).
Au Bas-Empire romain, la ville était protégée par une fortification, elle était le siège d'un commandement militaire (préfecture des Lètes de Condren, cf. la Notitia Dignitatum).
La ville médiévale
En 531, Saint Médard de Noyon y déplace le siège de l’évêché de la civitas Viromanduorum.
À l'époque mérovingienne, l'évêché de Noyon bénéficie de sa proximité avec Soissons, qui fut l'une des capitales du royaume franc et des palais voisins.
Né en Limousin vers 588, l'orfèvre Éloi devint monétaire de Clotaire II, puis trésorier de Dagobert Ier avant d'être élu évêque de Noyon (641). Fondateur de monastères à Solignac et à Paris, il accueillit sainte Godeberthe comme moniale à Noyon. Il meurt en 659/660.
Noyon est une ville importante au Moyen Âge. Charlemagne y est couronné roi des Francs en 768. En 891 après avoir pillé Balâtre, Roye et Roiglise, les Vikings font subir le même sort à Noyon. Hugues Capet y est sacré roi des Francs le 3 juillet 987 et les évêques de Noyon comptent au nombre des pairs ecclésiastiques du royaume de France.
En 1293, la ville est détruite par un incendie, à l'exception de deux établissements ecclésiastiques, l'abbaye Saint-Gilles et l'abbaye Saint-Barthélemy.
Jusqu'à la guerre de Cent Ans, le comté ecclésiastique de Noyon a un rôle stratégique entre le domaine royal (l'Île-de-France), les terres des comtes de Vermandois et des seigneurs de Boves-Coucy. La ville bénéficie d'institutions communales dès 1108 : la charte lui est concédée par l'évêque Baudry et confirmée plus tard par le roi.
Au début du XIVe siècle, Jean de Meudon est chanoine de Noyon.
En 1363, Noyon est transmis comme apanage à la maison de Bourgogne et reste composante du duché jusqu'à Charles Quint.
En 1430, Jeanne d'Arc est emprisonnée quelque temps à la petite prison de "l'Officialité du Chapitre " de Noyon, avant d'être vendue aux Anglais le 21 novembre de cette même année.
Noyon à l'époque moderne
Traité de Noyon du 13 août 1516 entre François Ier et Charles Quint (la France obtient le Milanais mais abandonne Naples). L'empereur restitue finalement le duché de Bourgogne à la France en 1544 au traité de Crépy-en-Laonnois.
La ville est définitivement française après le traité du Cateau-Cambrésis en 1559.
Le 2 août 1594, Henri IV prend la ville.
Ancienne viticulture
La vigne y fut longtemps cultivée. Au Moyen Âge, c'est même le terroir mieux adapté à la vigne qui fit choisir Noyon comme siège épiscopal plutôt que Saint-Quentin. L'hôtel de ville de Noyon, construit de 1485 à 1523, présente, dans ses frises et encadrements de fenêtres, de très nombreuses sculptures de grappes de raisin. À la fin du XVIIe siècle, Noyon produisait 5 000 pièces de vin de 216 pintes de Paris. Vers 1850, 124 vignerons en cultivaient 62 ha sur le territoire de la commune où on comptait encore 26 tonneliers et 5 marchands de vin. La production annuelle était encore de 340 000 litres, à Noyon on en consommait alors 13 500 litres. La vigne y était cultivée en hautains ou en fosses sur échalas. Les vendanges s'effectuaient le plus souvent début octobre. On trouve encore aujourd'hui de nombreuses traces de cette culture dans la dénomination des lieux-dits et des voiries de la commune (Vinottes, Berceau-Roger, Vigne-aux-Moines, etc.).
Disparition du diocèse de Noyon à la Révolution française
La ville est chef-lieu de district de 1790 à 1795.
L’évêché de Noyon est supprimé en 1790.
NOYON PENDANT LA GUERRE DE 1914-1918
Les Allemands entrèrent à Noyon le 30 août 1914. Le jour même, ils se livrèrent à des violences, à des meurtres même. Le maire et les deux adjoints durent conduire à travers la ville une colonne ennemie à l’étrier du commandant et furent frappés à coups de bois de lance, parce qu’ils avaient peine à suivre le pas des chevaux.
Rigoureuse dès le début, l’occupation le resta jusqu’à la fin. Tous les soirs, trois notables devaient se rendre, à 4 heures, à l’Hôtel de ville, siège de la Kommandantur, et y rester enfermés pendant 24 heures.
Les réquisitions furent continuelles, la ville dut subvenir aux frais d’entretien des troupes cantonnées sur son territoire et payer de fortes contributions en nature ou en argent (environ un million).
Les mesures vexatoires furent innombrables : défense de sortir après 8 heures du soir ; interdiction d’entretenir des lumières après 9 heures ; obligation de saluer poliment les officiers. Cette dernière obligation donna lieu à de constants rappels à l’ordre et emprisonnements.
Le vol et le pillage furent permanents : maisons abandonnées complètement mises à sac ; demeures vidées de leurs objets précieux, de leurs matelas, de leur linge ; coffres-forts fracturés. A la fin de février 1917, « par ordre supérieur », les « trésors et compartiments » de la Société Générale, ainsi que les coffres des autres banques, furent ouverts à l’aide de chalumeaux, et leur contenu emporté. On a estimé à 18 millions la valeur des titres volés.
Comme partout enfin, les Allemands ruinèrent les établissements industriels et notamment les scieries et les tanneries.
En mars 1917, les Allemands avaient tendu de larges inondations en dérivant le cours de la Verse, petite rivière qui traverse Noyon, et en faisant sauter les digues, barrages et écluses du Canal latéral de l’Oise.
Au moment de la retraite, les attentats et les violences redoublèrent. Ce furent d’abord les déportations en masse ; les personnes valides des deux sexes, capables de travailler, à l’exception des femmes ayant des petits enfants, furent emmenées ; les médecins, pharmaciens et prêtres partirent les premiers comme otages, tandis que les derniers convois comprenaient une cinquantaine de jeunes filles arrachées à leurs familles. Ce furent ensuite des pillages effrénés ; à peu près toutes les maisons furent cambriolées et saccagées, le mobilier et les marchandises, chargés par les équipes militaires sur des voitures et expédiés à l’arrière. Le 16 mars, la Kommandantur interdit de sortir des maisons ; les patrouilles avaient l’ordre de fusiller les personnes attrapées dans la rue.
Les carrefours de routes à l’entrée de Noyon, les ponts et autres ouvrages furent détruits par les mines.
Le 18 mars 1917 au matin, accueillie par les clameurs enthousiastes de la population, la cavalerie française pénétra dans Noyon par le faubourg de Paris, tandis que les dernières troupes allemandes sortaient de la ville par les portes opposées.
Pendant un an, de mars 1917 à mars 1918, Noyon fut animée par la présence de nombreuses troupes alliées. Pendant plusieurs mois, l’état-major de la 3è armée y résida. En janvier 1918, la ville passe dans le secteur britannique.
Subitement, les Allemands apparurent de nouveau le 25 mars 1918 aux portes de Noyon.
Le général Pellé, commandant le 5è corps engagé au nord et à l’est de Noyon, quitte la ville le 25 au soir, après avoir donnée l’ordre d’incendier les dépôts de la gare et les approvisionnements qu’on ne pouvait enlever. C’est à travers une cité complètement vide et violemment éclairée par les incendies, qu’en bon ordre, les divisions françaises gagnent leurs nouvelles positions au sud et au sud-ouest : les heures du Mont Renaud et de Porquéricourt. A 2 heures du matin, le 57è d’infanterie, chargé de couvrir la retraite, rétrograde à son tour en livrant de sanglants combats avec les avant-gardes ennemies dans les faubourgs. Les allemands se jettent sur la ville abandonnée.
Ils y demeurèrent jusqu’à la fin d’août. Le 28 de ce mois, les Français réoccupèrent de haute lutte Noyon.
A 5h30 du matin, le 28 août, après trente minutes d’un intense bombardement, qui entoure la ville d’un véritable rideau de feu, l’assaut est déclenché. Rapidement, à l’ouest et à l’est, malgré les fortins des mitrailleuses, les faubourgs sont pris par des zouaves. Ceux-ci parviennent vers 7 heures au quartier de cavalerie qui domine au nord Noyon et qui avait été incendié dès 1917.
Dans les ruines de la caserne se livre un combat farouche.
Landrimont, faubourg Est de Noyon, au bas des pentes de la colline du Mont Saint-Siméon, et les faubourgs nord sont emportés en même temps. Noyon, entièrement encerclé, est conquis.
Aussitôt, et bien qu’aucun soldat français ne soit encore entré dans la ville, un furieux bombardement s’abat sur elle. Pendant trois jours et trois nuits, les éclatements d’obus de gros calibres ou a gaz asphyxiants se succèdent sans interruption, allumant d’innombrables incendies, et bientôt des mines à retardement, semées un peu partout, commencent à exploser. Pendant près d’une semaine, il fut impossible de séjourner dans Noyon.
L’antique cité a perdu presque tout ce qui rappelait son passé, ses maisons anciennes en bois et torchis, ses élégants hôtels en pierre. Elle devra être l’objet d’une reconstitution à peu près totale.
Noyon, ville de garnison
Régiments stationnés au quartier Berniquet :
- 1890-1913 : 9e régiment de cuirassiers
- 1945-1962 : 7e régiment de cuirassiers
- 1962-1977 : 16e régiment de dragons
- 1977-1997 : 8e régiment d'infanterie
- 1997-2010 : Régiment de marche du Tchad
Le 7 juillet 2011, le Camp de Noyon est cédé pour 1 euro symbolique à la communauté de communes du Pays Noyonnais.